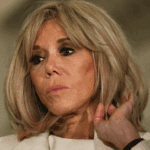Faut-il rendre les secours en montagne payants en cas d’imprudence : pourquoi ce vieux débat est à nouveau relancé
La montagne, majestueuse et indomptable, attire chaque année des millions d’amateurs de nature et de sensations fortes. Mais derrière la beauté des sommets se cache une réalité souvent négligée : la montagne peut être impitoyable pour les imprudents. Et si les secours sont gratuits en France, la question de leur facturation refait surface.

Chaque année, des milliers d’interventions mobilisent gendarmes, CRS, pompiers et hélicoptères dans les massifs français. Randonneurs épuisés, alpinistes blessés, familles égarées… quelles que soient les circonstances, l’intervention est intégralement prise en charge par l’État, qu’elle soit effectuée à pied ou par voie aérienne. Une exception subsiste toutefois sur les domaines skiables, où la souscription d’une assurance reste fortement recommandée.
Mais cette gratuité a un prix. L’heure de vol d’un hélicoptère de secours coûte plus de 5 000 euros, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Dans les Pyrénées, les équipes du PGHM et des CRS réalisent des milliers d’interventions chaque année : 4 312 pour les gendarmes et 2 038 pour les CRS entre janvier et août 2025, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.
Des comportements à risque de plus en plus fréquents

Le président du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, Kamel Chibli, tire la sonnette d’alarme : certains randonneurs s’aventurent en montagne sans préparation, voire en claquettes. Ces comportements irresponsables mobilisent des moyens considérables et exposent les sauveteurs à des dangers inutiles. Le ministre délégué François-Noël Buffet avait d’ailleurs évoqué la possibilité de revoir la règle de la gratuité en cas de faute manifeste. « Le principe de gratuité est inconditionnel, mais il peut subir des exceptions », déclarait-il en janvier, laissant entrevoir un débat sensible entre prévention, pédagogie et sanction.
Faut-il faire payer les imprudents ?
La question divise. Pour certains juristes, la frontière entre l’imprudence et l’accident involontaire est ténue, ce qui rendrait toute sanction difficile à justifier. L’avocate Stéphanie Baudot, spécialiste du droit de la montagne, souligne : « Sanctionner les abus peut sembler légitime, mais où placer le curseur ? » Pourtant, les cas d’interventions abusives se multiplient. De plus en plus de personnes appellent les secours sans réel danger, simplement parce qu’elles sont mal équipées ou surprises par la nuit. Dominique Lemblé, responsable du secours en montagne dans la Drôme, prévient : ces fausses alertes mobilisent inutilement des équipes qui pourraient sauver des vies ailleurs.
Des expérimentations locales déjà en place

Face à cette dérive, certaines collectivités ont décidé de réagir. Depuis le 1er mai 2025, le SDIS76 facture les sauvetages d’imprudents qui s’aventurent dans la cavité interdite de la falaise d’Étretat. Les contrevenants doivent s’acquitter d’une somme comprise entre 785 et 2 700 euros selon les cas. L’objectif est clair : responsabiliser les promeneurs et limiter les interventions injustifiées. D’autres départements observent cette initiative de près, envisageant d’instaurer un modèle similaire pour les situations jugées abusives.
Une comparaison européenne révélatrice
La France fait figure d’exception en Europe. Dans plusieurs pays voisins, les secours en montagne sont partiellement ou totalement payants. En Espagne, certaines régions facturent une partie des frais aux victimes. En Italie, dans le Val d’Aoste, les secours non médicaux dits « de confort » sont à la charge des intéressés. Quant à la Suisse, la célèbre REGA — la Garde Aérienne Suisse de Sauvetage — fait systématiquement payer ses interventions. Ces modèles étrangers reposent sur le principe du « payeur-prévention » : chacun doit assumer une part de responsabilité dans ses choix d’aventure.