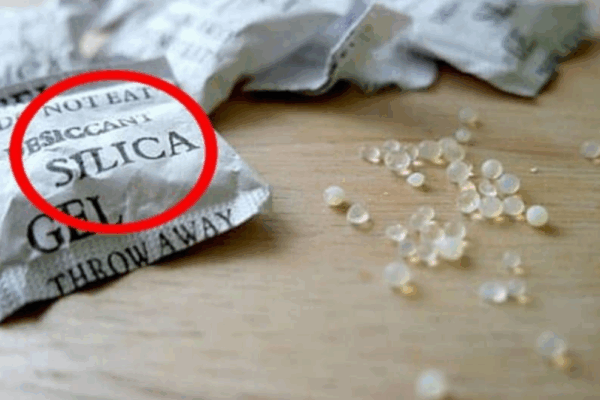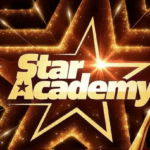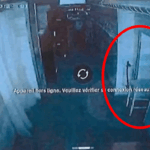En hiver, faut-il faire sécher son linge dehors ou dedans ?
À l’approche de l’hiver, une question simple mais récurrente revient dans les foyers français : comment sécher efficacement son linge quand les températures chutent ? Entre économies d’énergie, contraintes météo et astuces insoupçonnées, les réponses ne manquent pas. Mais toutes ne se valent pas…

Pour une partie des ménages français, le débat est vite tranché : le sèche-linge reste l’allié numéro un. En 2019, selon l’Ademe, 30 % des foyers en étaient équipés. Mais cette commodité a un coût : cet appareil figure au deuxième rang des plus gourmands en électricité, juste après le réfrigérateur. Avec une consommation moyenne de 301 kWh par an pour 183 cycles, cela représente environ 62 euros à l’année. De quoi faire réfléchir les 70 % de Français qui s’en passent encore, d’autant plus en période d’augmentation des prix de l’énergie.
Séchage extérieur en hiver : une solution sous-estimée

Peu de gens le savent, mais faire sécher son linge dehors même par des températures négatives est tout à fait possible — et même conseillé dans certaines conditions. Ce phénomène s’appuie sur un processus physique bien connu des scientifiques : la sublimation. Il s’agit du passage direct de l’état solide à l’état gazeux, sans passer par le liquide. Ainsi, lorsque le linge gèle, l’humidité qu’il contient peut s’évaporer sans fondre, accélérant ainsi le séchage malgré le froid.
L’ozone et le vent : des alliés naturels

Outre la sublimation, d’autres éléments rendent le séchage extérieur efficace. Le vent, tout d’abord, accélère l’évaporation des molécules d’eau, même à basse température. Ensuite, l’ozone — ce gaz naturellement présent dans l’air — possède des propriétés antibactériennes intéressantes. Résultat : un linge qui sèche plus vite, sans odeurs stagnantes et avec une fraîcheur naturelle. Une option qui reste idéale si l’on bénéficie d’un extérieur sec, dégagé, et si l’on ne vit pas en immeuble où l’étendage est parfois interdit.
En intérieur : attention à l’humidité

Reste le cas classique : sécher son linge à l’intérieur, lorsque sortir les vêtements n’est pas envisageable. C’est souvent le cas en milieu urbain, ou par temps pluvieux et humide. Problème : cette solution peut entraîner une augmentation importante du taux d’humidité ambiant. Condensation sur les vitres, développement de moisissures et sensation de froid humide peuvent vite devenir un cauchemar domestique. Il est donc essentiel d’ouvrir les fenêtres régulièrement pour aérer, ou au minimum, de ventiler efficacement la pièce.
Quand le linge devient un humidificateur naturel

Il existe toutefois une exception utile : dans les logements trop secs, étendre du linge humide peut rééquilibrer l’hygrométrie. Ce cas de figure se rencontre fréquemment dans des appartements bien chauffés, où l’air devient trop sec pour les muqueuses et les voies respiratoires. Dans ce contexte, le linge joue alors un rôle bénéfique. Mais cela doit rester maîtrisé et ponctuel pour éviter les excès.
La solution technique : le déshumidificateur
Enfin, pour ceux qui n’ont ni sèche-linge ni possibilité d’étendre à l’extérieur, le recours à un déshumidificateur peut être salutaire. Cet appareil aspire l’humidité ambiante, favorise un séchage rapide et préserve la qualité de l’air. Il s’utilise idéalement dans une pièce fermée, à proximité du linge, pendant quelques heures. Un investissement utile en hiver, particulièrement dans les petits logements où chaque mètre carré compte.