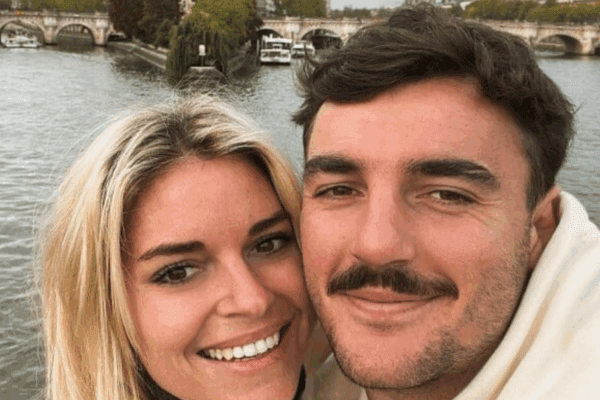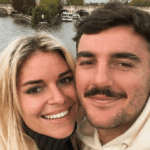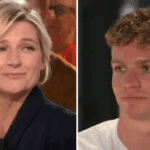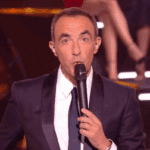Contrôles d’identité « au faciès »: la France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme
Dans un contexte de tensions persistantes entre citoyens et forces de l’ordre, la Cour européenne des droits de l’homme a infligé un rappel juridique et symbolique à la France. Pour la première fois, un contrôle d’identité jugé discriminatoire aboutit à une condamnation par la CEDH. Une victoire partielle pour les requérants, mais un signal fort pour l’Europe.

Ce jeudi 26 juin, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu que la France avait enfreint les principes d’égalité et de respect de la vie privée dans le cas de Karim Touil, un homme soumis à trois contrôles d’identité en dix jours, sans justification objective. La Cour a estimé que l’État n’a pas su prouver l’absence de discrimination dans ces contrôles répétés. En conséquence, la France est condamnée à lui verser 3.000 euros pour préjudice moral.
Cette décision s’appuie sur l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui proscrit la discrimination, associé à l’article 8, garantissant le droit au respect de la vie privée. Une reconnaissance judiciaire d’un contrôle « au faciès », dans un système où cette pratique a souvent été dénoncée sans jamais être pleinement sanctionnée à l’échelle européenne.
Une reconnaissance partielle pour une bataille collective

Karim Touil n’était pas seul dans cette démarche : cinq autres requérants d’origine africaine ou nord-africaine, habitant Roubaix, Marseille, Vaulx-en-Velin, Saint-Ouen et Besançon, avaient également saisi la CEDH. Tous affirmaient avoir été ciblés arbitrairement, en raison de leur apparence. Pourtant, la Cour a rejeté leurs demandes, estimant que les éléments ne suffisaient pas à prouver une intention discriminatoire dans leurs cas respectifs.
L’avocat Slim Ben Achour, qui défendait les six hommes, salue malgré tout une avancée majeure, rappelant qu’en 2016, la Cour de cassation française avait déjà reconnu des contrôles discriminatoires comme illégaux. Il estime que la décision européenne impose désormais à la France, mais aussi aux autres États membres, de prendre des mesures concrètes pour éliminer ces pratiques “particulièrement odieuses”.
Un combat judiciaire long et semé d’embûches
La procédure engagée remonte à plus d’une décennie. Après avoir été déboutés par la justice française en première instance en 2013, les plaignants avaient en partie obtenu gain de cause en appel en 2015, avec la condamnation de l’État à indemniser cinq d’entre eux. Trois décisions furent confirmées par la Cour de cassation en 2016, marquant un précédent juridique inédit. Les six autres, insatisfaits, portèrent alors l’affaire devant la CEDH en 2017.
Cette mobilisation judiciaire a mis en lumière les lacunes structurelles du droit français face aux contrôles d’identité discriminatoires, ainsi que l’absence de mécanismes de traçabilité permettant aux citoyens de contester un contrôle abusif.
Une réalité toujours bien ancrée dans les pratiques

Si la condamnation reste isolée, les données compilées par le Défenseur des droits révèlent une réalité systémique. Une enquête publiée mardi, portant sur un échantillon de plus de 5.000 personnes, montre que 26 % des Français ont été contrôlés au moins une fois entre 2019 et 2024, contre 16 % entre 2011 et 2016.
Le constat est encore plus criant pour les hommes jeunes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins, qui sont quatre fois plus exposés à un contrôle et douze fois plus à des fouilles ou palpations. Plus inquiétant encore, 52 % des personnes contrôlées n’ont reçu aucune justification, et près de 20 % ont rapporté des comportements déplacés des forces de l’ordre : tutoiements, provocations, violences verbales ou physiques.
Vers des réformes concrètes ?
Face à ce tableau, la Défenseure des droits Claire Hédon plaide pour des mesures correctives fortes. Elle propose notamment la traçabilité systématique des contrôles d’identité, via la remise d’un récépissé, afin de permettre un éventuel recours en cas de traitement discriminatoire. Cette exigence de transparence, longtemps débattue puis écartée du débat politique, revient désormais avec insistance.