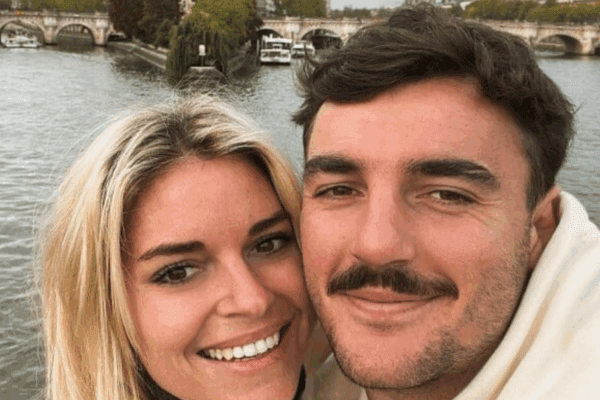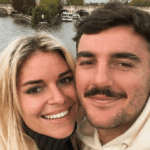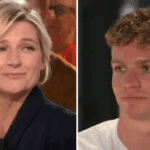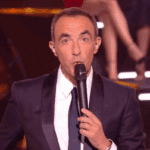« C’est l’État qui dépense pour nous »: pourquoi les Français n’ont pas mis autant d’argent de côté depuis… 1979
Malgré un contexte de reprise partielle du pouvoir d’achat, les Français continuent d’accumuler une épargne record. Un réflexe de prudence qui inquiète autant qu’il rassure, révélateur d’un climat de défiance persistante face à l’avenir, sur fond d’instabilité économique et démographique.
Au premier trimestre 2025, le taux d’épargne des ménages français a bondi à 18,8 %, selon l’Insee, un sommet historique hors période Covid, dépassant même les niveaux de 1979. Le taux d’épargne financière atteint, lui, 9,8 %, un niveau jamais observé en dehors des confinements sanitaires. Un phénomène d’autant plus frappant que la hausse du revenu disponible (+12,7 % sur deux ans) s’accompagne d’un reflux de l’inflation et d’un regain partiel de pouvoir d’achat.
Pourtant, la consommation ne suit pas le même rythme, n’ayant augmenté « que » de 11 % sur la même période. Et au premier trimestre 2025, elle a même reculé de 0,2 %. En d’autres termes, les Français préfèrent continuer à épargner plutôt que de consommer davantage, à rebours des espoirs formulés par les économistes en sortie de crise sanitaire.
Une prudence dictée par l’anxiété collective
Pourquoi cette réticence à relancer la consommation ? Pour Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Épargne, les raisons sont à chercher dans un climat de tension généralisée. Depuis 2020, une succession de chocs – pandémie, guerre en Ukraine, inflation, tensions politiques intérieures, crise budgétaire – ont entamé durablement la confiance des ménages.
À cela s’ajoute une peur croissante du chômage, nourrie par les annonces de plans sociaux et le ralentissement de plusieurs secteurs clés. Le vieillissement de la population joue également un rôle structurel, en incitant les ménages plus âgés à se constituer un capital en prévision de la retraite.
Autre facteur de fond : la théorie de l’équivalence ricardienne. Lorsqu’un État s’endette lourdement, comme c’est le cas en France, les ménages anticipent des hausses futures d’impôts pour combler le déficit. Résultat : ils épargnent davantage dès aujourd’hui pour s’en prémunir.
Le poids de l’État, un frein paradoxal à la consommation
Christian Parisot, conseiller chez Aurel BCG, met quant à lui en cause la part prépondérante de l’État dans les dépenses sociales. Selon lui, les Français n’ont pas toujours conscience que leur consommation est en partie « déléguée » à l’État, via la Sécurité sociale, l’éducation ou les aides au logement.
« Si on gérait nous-mêmes certaines dépenses, on serait amenés à consommer davantage », avance-t-il. À ses yeux, une trop forte prise en charge publique détourne les ménages de leurs arbitrages économiques directs, ce qui pourrait contribuer au maintien d’un taux d’épargne élevé.
Une situation à double tranchant pour les finances publiques
L’épargne record des Français pose une équation complexe pour l’exécutif. D’un côté, cette prudence pénalise la croissance en limitant la consommation intérieure, traditionnel moteur de l’économie hexagonale. D’un autre côté, ce bas de laine rassure les marchés financiers.
Avec un taux d’épargne proche de 20 %, la France inspire confiance aux agences de notation, qui maintiennent une notation relativement stable malgré une dette publique galopante. À titre de comparaison, un taux d’épargne proche de 4 % – comme aux États-Unis – serait jugé bien plus risqué dans une telle configuration budgétaire.
L’État peut-il inciter les Français à desserrer leur épargne ?
Le gouvernement cherche des solutions. Une piste évoquée récemment : créer un produit d’épargne dédié au financement de la défense. Mais l’enthousiasme est très limité. D’après un sondage Ifop, seuls 29 % des Français accepteraient d’orienter leur épargne vers ce type de placement, preuve que le lien entre patriotisme économique et confiance budgétaire reste ténu.
Et l’idée même « d’orienter » l’épargne suscite la méfiance. Philippe Crevel souligne un malentendu sémantique : les épargnants craignent une forme de contrainte, alors que le gouvernement parle d’incitation. Le souvenir des réquisitions d’épargne, même symboliques, demeure dans les esprits.