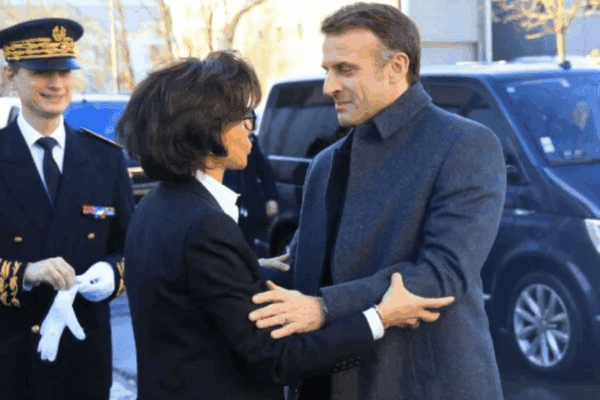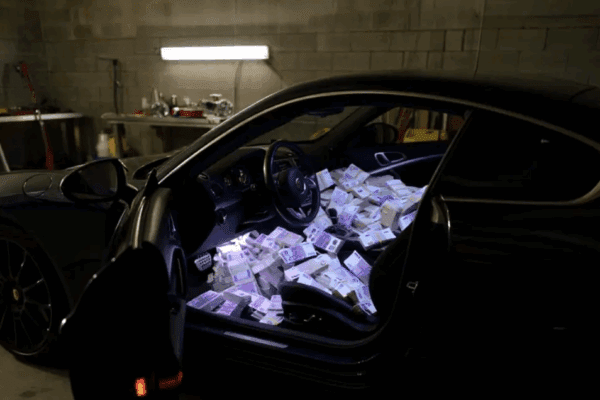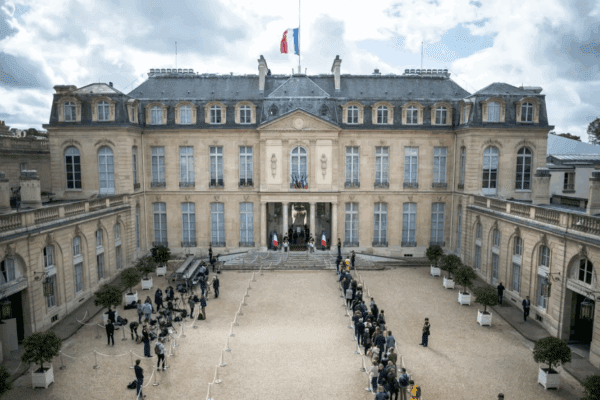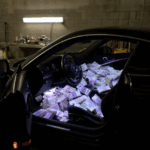Cancers : une augmentation de 80 % en trois décennies chez les moins de 50 ans… pourquoi les diagnostics grimpent autant chez les jeunes ?
Longtemps considérée comme une maladie touchant surtout les seniors, le cancer frappe désormais de plus en plus de jeunes adultes.

Les chiffres, alarmants, confirment une tendance mondiale : en trois décennies, le nombre de cas chez les moins de 50 ans a presque doublé. Les experts pointent du doigt un mode de vie moderne de plus en plus délétère pour la santé.
Selon une étude publiée dans le British Medical Journal (BMJ) en 2023, le nombre de nouveaux cas de cancer chez les moins de 50 ans a bondi de 79,1 % entre 1990 et 2019, passant de 1,82 million à 3,26 millions dans le monde.
Si cette progression reste relative en proportion de la population totale, elle témoigne d’un bouleversement épidémiologique majeur. Les formes les plus fréquentes sont les cancers colorectaux, du pancréas, de l’estomac et du sein, mais les chercheurs observent également une hausse notable des tumeurs cérébrales et rénales.
Les moins de 50 ans sont désormais loin d’être épargnés, et ce constat inquiète la communauté médicale internationale, qui y voit un symptôme de changements profonds dans les comportements et l’environnement.
Une tendance confirmée en France
La tendance mondiale se retrouve aussi dans l’Hexagone. Selon Santé publique France (mars 2025), les diagnostics de cancers précoces sont en nette augmentation depuis vingt ans. Chez les 14 à 39 ans, les cancers colorectaux ont progressé de 1,4 %, les cancers du sein de 1,6 %, ceux du rein de 4,5 %, et les glioblastomes (tumeurs cérébrales) de 6,1 %.
Ces données traduisent un changement silencieux mais profond dans le profil des malades. Autrefois marginale, cette population de jeunes adultes diagnostiqués est aujourd’hui un enjeu majeur pour la prévention et la recherche médicale.
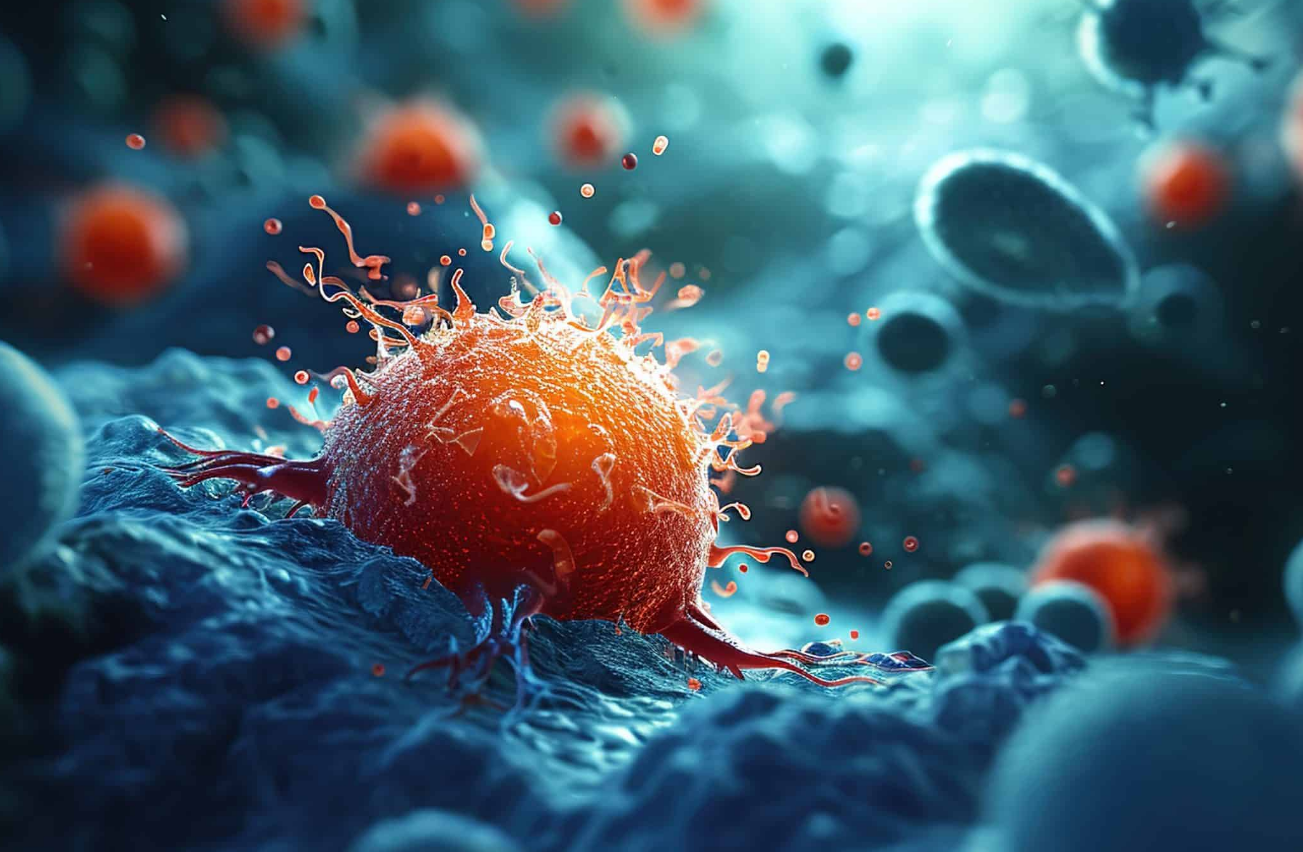
Les causes : une société qui favorise les risques
Comment expliquer cette explosion des cancers avant 50 ans ? Les spécialistes évoquent une combinaison de facteurs biologiques, environnementaux et comportementaux.
Certes, les dépistages sont plus nombreux et plus efficaces, permettant d’identifier des cancers plus précocement. Mais cela n’explique pas à lui seul une telle hausse.
Pour Sandrine Etienne-Manneville, chercheuse à l’Institut Pasteur, les modes de vie modernes jouent un rôle déterminant :
« On soupçonne que nos habitudes quotidiennes y participent : alimentation ultra-transformée, sédentarité, surpoids, exposition aux perturbateurs endocriniens ou aux substances chimiques présentes dans l’environnement. »
Ces facteurs combinés créent un terrain propice aux dérèglements cellulaires, surtout lorsqu’ils s’installent dès l’enfance ou l’adolescence.
L’alimentation et la sédentarité dans le viseur
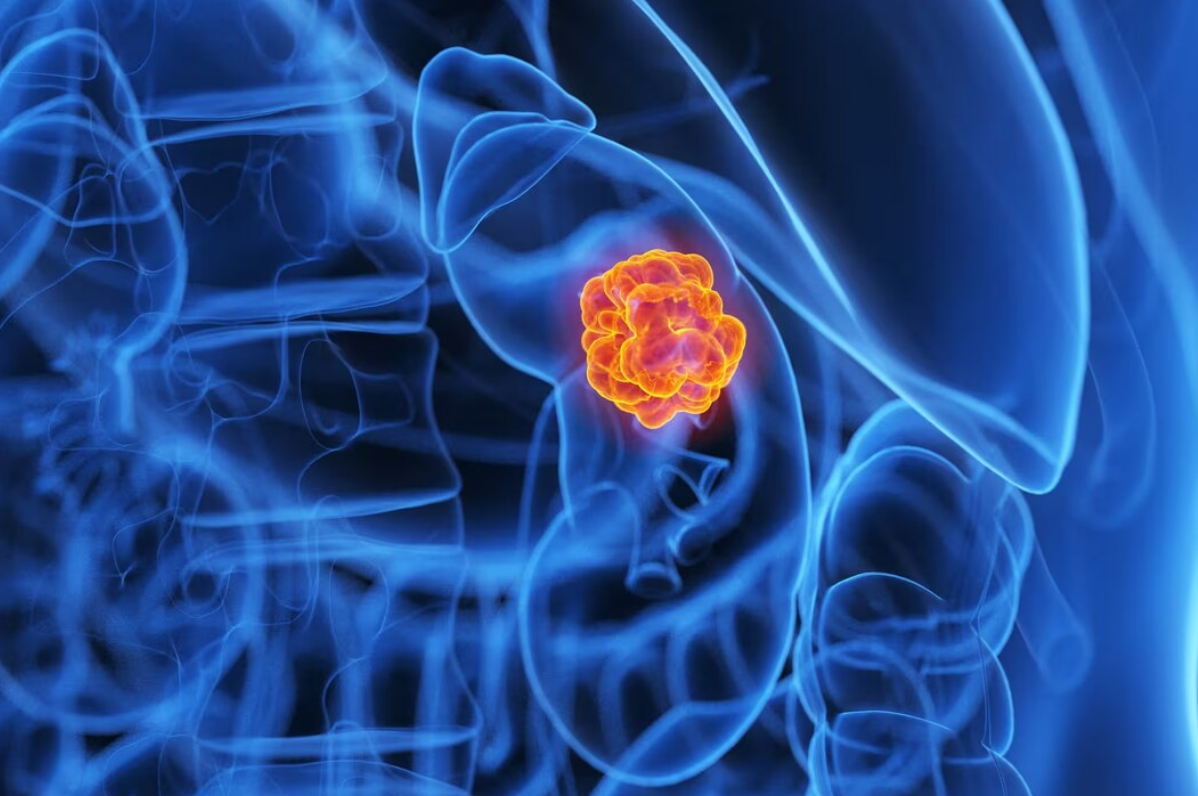
Plusieurs études récentes ont mis en évidence le lien entre une alimentation industrielle riche en sucres, graisses et additifs et le développement de certains cancers digestifs. La sédentarité accrue, favorisée par les écrans et le télétravail, aggrave encore ce risque, notamment par son impact sur le métabolisme et l’inflammation chronique.
Le surpoids, l’alcool et le tabac demeurent également des facteurs aggravants, mais de nouveaux suspects émergent : microplastiques, pollution atmosphérique et stress chronique.
Le corps médical tire la sonnette d’alarme : nos modes de vie actuels, s’ils ne sont pas profondément revus, pourraient faire des cancers précoces un phénomène de plus en plus courant au XXIᵉ siècle.
Vers un dépistage plus précoce et plus ciblé
Face à cette réalité, les autorités de santé réfléchissent à un dépistage plus adapté aux nouvelles générations.
Des recherches sont en cours pour développer des tests sanguins capables de repérer des marqueurs biologiques du cancer avant même les premiers symptômes. Ces “biopsies liquides”, déjà à l’étude dans plusieurs pays, pourraient révolutionner la prévention et le diagnostic.
Mais la clé réside aussi dans l’éducation à la santé et la prévention active : mieux informer les jeunes sur les risques liés à l’alimentation, au manque de mouvement et aux substances toxiques pourrait réduire considérablement les futures statistiques.