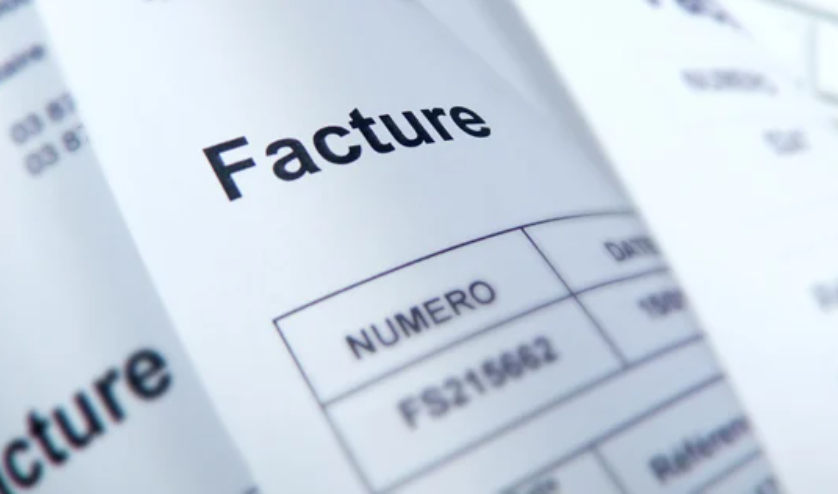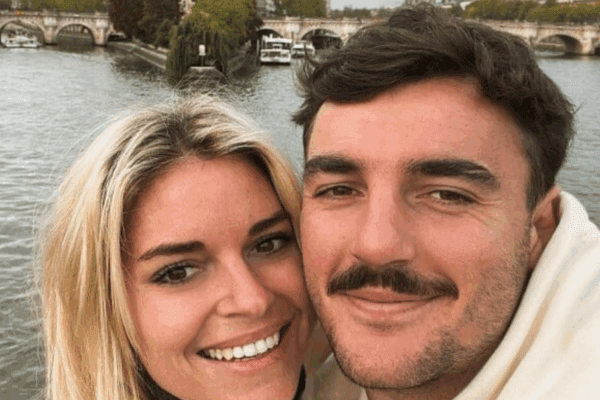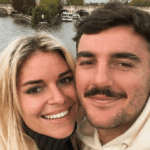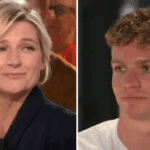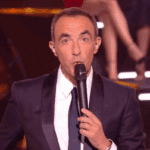Âgée de 78 ans et malade, cette retraitée doit payer les factures de ses squatteurs « précaires »
À Nantes, une retraitée de 78 ans se retrouve privée de son bien immobilier et de ses revenus locatifs, à cause de l’occupation illégale de son appartement. Une affaire discrète mais révélatrice, qui soulève une nouvelle fois la tension autour des droits des propriétaires face à ceux des occupants précaires.
Depuis plus d’un an et demi, une femme âgée ne peut plus accéder à un appartement dont elle est pourtant légalement propriétaire. Il s’agit d’un T5, hérité de son père en 1998 et qu’elle louait depuis pour compléter une retraite modeste. Le logement est aujourd’hui occupé sans droit ni titre par une famille en situation de précarité, ce qui empêche la propriétaire de percevoir les 1 000 euros de loyer mensuels qui lui étaient essentiels pour vivre dignement.
Une situation figée malgré les démarches officielles
Dès le printemps 2024, la fille de la retraitée – qui gère les démarches à distance – a engagé les procédures classiques pour obtenir l’expulsion des occupants, notamment en sollicitant la préfecture et en faisant constater la situation par huissier. Pourtant, malgré ces initiatives légales, la procédure a été suspendue. Le motif ? Le statut jugé fragile des squatteurs, en particulier la présence de deux jeunes enfants dans la famille, âgés de un et deux ans, et l’absence de solution d’hébergement malgré les appels au 115.
Une décision judiciaire difficile à comprendre
Pour la famille propriétaire, la décision du tribunal de suspendre l’expulsion reste incompréhensible et profondément injuste. Bien que le tribunal ait reconnu que la famille n’avait ni titre de séjour au sein du logement, ni solution alternative immédiate, il a tout de même priorisé la protection des mineurs. Une logique humanitaire qui, dans ce cas précis, entraîne une lourde conséquence financière et psychologique pour la propriétaire légitime du bien.
Une détresse grandissante pour la propriétaire
Les conséquences concrètes de cette occupation prolongée sont multiples : la retraitée ne perçoit plus de revenus locatifs et doit assumer seule des charges qui s’accumulent. Sa fille rapporte notamment une facture d’eau particulièrement élevée causée par l’occupation du logement, ainsi que une taxe foncière de 1 800 euros impayée depuis 2024, faute de moyens. La situation devient insoutenable, forçant la fille à soutenir sa mère financièrement, tout en préparant un recours devant le tribunal judiciaire – une procédure longue et coûteuse.
Un arbitrage délicat entre précarité et droit de propriété
Face à ce blocage, la préfecture affirme examiner la possibilité de débloquer la situation par une nouvelle mesure administrative, tout en recherchant une alternative d’hébergement pour la famille occupant les lieux. L’objectif annoncé est de permettre la libération du logement sans créer une situation d’extrême urgence pour les enfants concernés. Mais cette lenteur procédurale soulève des interrogations : jusqu’où les droits des propriétaires peuvent-ils être mis en suspens au nom de considérations humanitaires ?
Une affaire symptomatique d’un débat plus large
Le cas de cette retraitée de Nantes, bien qu’isolé en apparence, illustre les limites du système actuel face aux occupations illégales dans un contexte de crise du logement. Si la nécessité de protéger les plus vulnérables est indiscutable, la multiplication des cas similaires pourrait décourager les petits propriétaires de mettre des biens sur le marché locatif. Une dynamique préoccupante, dans un pays déjà confronté à des pénuries de logements accessibles. En attendant une décision judiciaire définitive, la retraitée demeure, elle, prisonnière d’un flou juridique et d’une lenteur administrative difficilement soutenables.