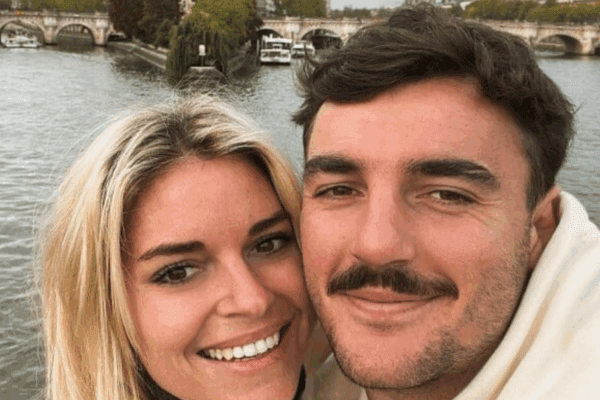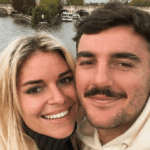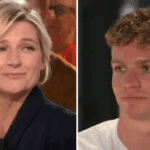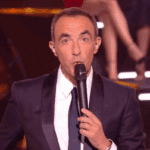L’ex-ministre Amélie Oudéa-Castera réagit à la polémique sur son salaire
Deux jours après son élection à la tête du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Amélie Oudéa-Castéra fait déjà face à une polémique : la question de son futur salaire, estimé à 9 000 euros mensuels, provoque des remous. Une controverse qu’elle tente de désamorcer en s’appuyant sur la légalité et la continuité administrative.
Le 19 juin 2025, Amélie Oudéa-Castéra est élue à l’unanimité présidente du CNOSF, quelques mois après avoir quitté son poste de ministre des Sports. En pleine réorganisation du paysage sportif français post-Jeux olympiques, sa nomination semblait logique, presque attendue. Pourtant, le timing de sa prise de fonction coïncide avec une révélation du Canard enchaîné, selon laquelle l’ex-ministre aurait demandé un salaire de 9 000 euros par mois.
Une annonce qui n’a pas tardé à susciter la critique, dans un climat où les rémunérations des hauts responsables associatifs sont scrutées de près. D’autant plus que son prédécesseur, David Lappartient, occupait ce même poste… à titre bénévole.
Une réponse ferme face à la controverse
Invitée sur France Info, Amélie Oudéa-Castéra s’emploie à éteindre l’incendie. Non, affirme-t-elle, elle n’a « ni demandé, ni obtenu » ce salaire pour le moment. Elle précise que la question sera tranchée par le conseil d’administration, suivi d’un vote en assemblée générale. Ce processus, insiste-t-elle, est parfaitement encadré par la loi et conforme aux pratiques internes du CNOSF.
« Je souhaite simplement que s’appliquent les règles déjà en vigueur pour mes prédécesseurs », déclare-t-elle, en rappelant qu’elle occupera cette fonction « à titre principal ». Autrement dit, elle n’exercera pas d’autre emploi en parallèle, à la différence de David Lappartient, qui cumulait responsabilités sportives et fonctions internationales.
Une rémunération qui respecte un cadre légal
Pour appuyer son propos, la nouvelle présidente précise que le montant évoqué est calé sur le plafond de la Sécurité sociale, comme le prévoit la réglementation applicable aux associations reconnues d’utilité publique. Elle souligne que le régime qu’elle souhaite activer n’est ni nouveau, ni exceptionnel, mais existe depuis plusieurs années au sein de l’organisation.
Elle rappelle en outre que même si David Lappartient ne percevait pas cette rémunération, les crédits prévus à cet effet figuraient bel et bien dans les comptes du CNOSF. « Je ne fais que poursuivre un dispositif existant », insiste-t-elle, réfutant tout privilège ou traitement de faveur.
Une question d’engagement et de charge de travail
Au fond de la défense d’Amélie Oudéa-Castéra se trouve un argument de fond : la nature même de la fonction. Selon elle, présider le CNOSF à plein temps justifie une compensation financière, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres grandes fédérations sportives ou comités olympiques étrangers.
En mettant en avant la nécessité d’un engagement total dans une période de transition pour le sport français, elle tente de replacer la polémique dans un cadre rationnel, administratif et professionnel. Le poste, autrefois symbolique et honorifique, nécessite désormais une disponibilité complète, selon sa lecture.
Une polémique révélatrice du climat ambiant
Si cette affaire prend autant d’ampleur, c’est aussi le reflet d’une sensibilité accrue des Français face aux questions de rémunération des responsables publics ou issus du monde politique. Amélie Oudéa-Castéra, déjà exposée à plusieurs controverses durant son passage au ministère, ne bénéficie d’aucun état de grâce, et sa nomination, bien que légitime sur le papier, reste marquée par une forme de méfiance persistante.
Dans un contexte où le monde associatif et sportif revendique l’éthique, la sobriété et la transparence, chaque euro dépensé est scruté. Sa défense juridique, bien que rigoureuse, suffira-t-elle à apaiser les critiques sur le fond ? Rien n’est moins sûr.