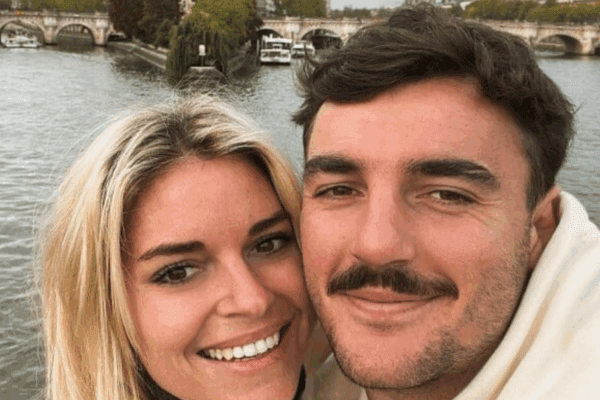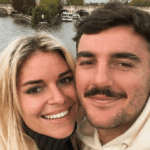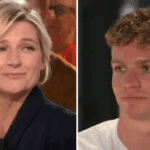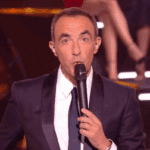Le café le plus cher du monde provient des crottes d’un petit animal
Derrière sa réputation luxueuse et son prix exorbitant, le kopi luwak cache une histoire aussi insolite que déroutante. Ce café venu d’Asie du Sud-Est tire sa particularité de son processus de fabrication… par les voies digestives d’un petit mammifère. Retour sur l’origine étonnante du café le plus cher au monde.
Le kopi luwak ne serait qu’un café parmi d’autres s’il ne tenait sa renommée de son mode de production aussi singulier qu’inhabituel. Contrairement aux méthodes classiques de torréfaction, ce breuvage haut de gamme voit le jour dans les entrailles d’un animal : la civette asiatique. Cet animal nocturne, proche du chat, se nourrit notamment des cerises mûres du caféier. Après ingestion, les noyaux – autrement dit les grains de café – traversent son système digestif sans être détruits.
Le secret de ce café réside dans la fermentation naturelle qu’il subit au cours de la digestion. Les enzymes présentes dans l’appareil digestif de la civette modifient subtilement la composition chimique des grains, atténuant leur acidité et leur conférant une saveur plus ronde, plus douce, parfois décrite comme « chocolatée » ou « caramélisée ». Les grains, expulsés presque intacts avec les excréments, sont ensuite collectés, lavés, séchés et torréfiés.
La civette, actrice essentielle du goût
La civette, ou luwak en indonésien, est un petit carnivore discret, reconnaissable à sa queue fine et longue, son museau rappelant celui d’un raton laveur, et ses tâches marbrées sur le pelage. Présente en Asie du Sud-Est mais aussi dans certaines régions d’Afrique, elle joue un rôle central dans la création du kopi luwak. Non seulement son appareil digestif préserve les grains, mais il les transforme aussi en douceur.
Ce traitement naturel contribue à réduire les composés responsables de l’amertume, laissant place à un arôme plus délicat et raffiné, ce qui fait toute la rareté de ce café. Toutefois, ce procédé biologique repose sur la consommation libre des cerises les plus mûres, que la civette choisit instinctivement dans la nature – un comportement capital pour garantir la qualité du produit final.
Une invention née de la frustration
L’histoire du kopi luwak remonte à l’époque coloniale, au XVIIIe siècle en Indonésie, lorsqu’il était interdit aux ouvriers indigènes des plantations de café de consommer les grains qu’ils récoltaient. Ne pouvant goûter au fruit de leur travail, ces fermiers observèrent que les civettes, elles, se nourrissaient librement des fruits du caféier.
Les travailleurs ont alors commencé à ramasser les excréments des civettes dans les plantations, dans lesquels ils retrouvaient les précieuses graines. Nettoyés avec soin, séchés puis torréfiés, ces grains devinrent leur seul moyen de savourer un café qui leur était autrement inaccessible. Une pratique empirique qui donna naissance à l’un des cafés les plus prisés (et controversés) de la planète.
Une renommée mondiale, mais des dérives inquiétantes
Aujourd’hui, le kopi luwak est devenu un symbole de luxe, parfois vendu à plus de 1000 € le kilo. Ce succès fulgurant a toutefois entraîné des conséquences dramatiques. Face à la demande, des producteurs ont commencé à élever des civettes en captivité, dans des conditions souvent déplorables, les nourrissant exclusivement de cerises de café, au mépris de leur bien-être.
Ce mode d’élevage industriel compromet non seulement la qualité du café, car les animaux ne choisissent plus librement les meilleurs fruits, mais il soulève aussi des questions éthiques majeures. De nombreuses voix s’élèvent désormais pour appeler à un retour aux pratiques d’origine : la collecte de grains uniquement issus de civettes sauvages.