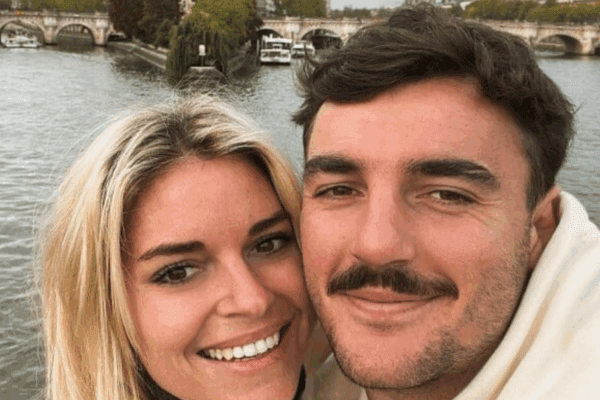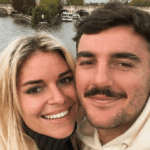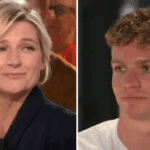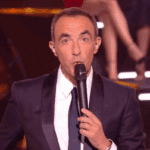Jordan Bardella interpelle : pourquoi de nombreux Français ressentent-ils un malaise dans leur propre pays ?
Dans un climat politique où les tensions identitaires refont surface, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, relance le débat avec une déclaration percutante.

Il évoque un mal-être croissant chez de nombreux Français, qui affirment ne plus se sentir chez eux dans le pays où ils ont grandi. Analyse d’un discours qui divise. Le 30 juin 2025, Jordan Bardella a jeté un nouveau pavé dans la mare en déclarant que « beaucoup de Français ne se sentent plus chez eux dans le pays où ils ont grandi ». Loin d’être une simple provocation, cette phrase révèle un malaise plus profond qui traverse une partie de la société. Le président du RN n’en est pas à son premier coup d’éclat rhétorique, mais cette sortie, dans un contexte d’instabilité politique et de crispation sociale, a trouvé un écho particulièrement fort dans l’opinion publique.
Une partie de la population partage ce sentiment de décalage, évoquant un pays qui changerait trop vite, au détriment de ses racines. Si cette perception n’est pas nouvelle, sa résurgence dans le débat public interroge : est-elle le symptôme d’un réel déracinement ou l’effet d’un discours politique bien rodé ?
Une inquiétude ancrée dans les territoires
Le propos de Bardella s’appuie sur un ressenti fréquemment exprimé dans les zones périurbaines et certains quartiers populaires, souvent qualifiés de « sensibles ». Ces territoires ont été le théâtre de profondes mutations démographiques, économiques et sociales ces dernières décennies. Pour nombre de leurs habitants, le paysage urbain, le tissu commerçant ou encore le vivre-ensemble ont été bouleversés, nourrissant une impression de perte d’identité locale.

Dans ce cadre, l’attachement à une « France de toujours » ressurgit régulièrement dans les discours publics, souvent en opposition à l’idée d’une France en mouvement ou métissée. Le RN, fidèle à sa ligne, s’appuie sur ces ressentis pour ancrer son discours dans une certaine nostalgie collective.
Le Rassemblement national en quête de stabilité électorale
La stratégie du RN, désormais pilotée par Jordan Bardella, consiste à canaliser ces inquiétudes à des fins électorales. En insistant sur les « changements trop rapides », Bardella cherche à rassurer une frange de l’électorat qui se sent dépossédée de son cadre de vie, parfois déroutée par l’évolution des normes culturelles ou le recul supposé de certaines traditions.
Dans cette logique, le discours sur l’identité devient un outil de clivage assumé : opposer ceux qui veulent « préserver » à ceux qui « accompagnent le changement ». Le chef de file du RN manie cet argumentaire avec aisance, intégrant même sa vie personnelle dans les médias, comme lorsqu’il évoque ses conceptions sur la famille face à Karine Le Marchand – un mélange de vie publique et privée qui lui permet de rester au centre de l’attention médiatique.
Les racines sociétales d’un malaise grandissant

Ce sentiment de déclassement ou d’aliénation ne se limite pas aux discours politiques. Sur le terrain, de nombreux citoyens disent ne plus reconnaître leur quotidien : commerces fermés, services publics réduits, lien social affaibli, montée des incivilités… Autant d’éléments qui participent à une impression d’abandon ou de fracture.
La disparition de repères collectifs nourrit une nostalgie du passé, perçue comme plus stable, plus sûre. Les changements urbains rapides, conjugués à la précarisation croissante de certains quartiers, accentuent ce malaise. Dans ce contexte, les déclarations de Bardella trouvent un écho parce qu’elles donnent un visage politique à un ressenti diffus.
La diversité des réponses locales
Face à ce climat, les collectivités, les associations et les institutions locales tentent d’apporter des réponses concrètes. Certaines municipalités investissent dans la rénovation urbaine, la mixité sociale ou la participation citoyenne, avec pour objectif de restaurer le sentiment d’appartenance.
Des maisons de quartier, des événements culturels ou des dispositifs d’insertion voient le jour, visant à renforcer les liens entre générations et cultures. Toutefois, ces initiatives demeurent souvent insuffisamment relayées à l’échelle nationale, là où le discours alarmiste de certains responsables politiques occupe l’espace médiatique.
Des solutions qui divisent la classe politique

Le diagnostic posé par Jordan Bardella n’est pas rejeté en bloc par l’ensemble de la classe politique, mais les réponses qu’il propose divisent profondément. Tandis que le RN mise sur le contrôle migratoire et le retour à des « valeurs fondamentales », d’autres courants privilégient l’investissement dans l’éducation, l’inclusion et le renouvellement des politiques sociales.
Les débats se cristallisent autour de deux visions : une France qui se protège contre l’extérieur, et une France qui s’adapte et intègre. Cette divergence alimente une polarisation politique déjà bien entamée, où chaque camp tente d’imposer sa lecture de la réalité.
Une stratégie politique assumée
Avec ce type de prise de position, Jordan Bardella ancre davantage le RN dans une stratégie identitaire, fidèle à l’héritage de Jean-Marie et Marine Le Pen. Son objectif est double : conforter son électorat traditionnel et séduire les abstentionnistes, notamment dans les zones rurales ou désindustrialisées.
En s’appuyant sur une rhétorique émotionnelle forte, il vise à structurer un bloc électoral autour de la notion d’identité nationale, face à une société perçue comme éclatée. Ce faisant, il tente de faire de l’identité non pas une question secondaire, mais l’axe central du débat démocratique.
Vers un nouveau clivage politique ?
À travers cette déclaration et d’autres précédentes, Jordan Bardella ne se contente pas de commenter la société : il contribue à en redessiner les lignes de fracture. Il oppose ceux qui veulent ralentir le changement à ceux qui l’accompagnent, ceux qui regrettent une époque révolue à ceux qui embrassent la diversité contemporaine.