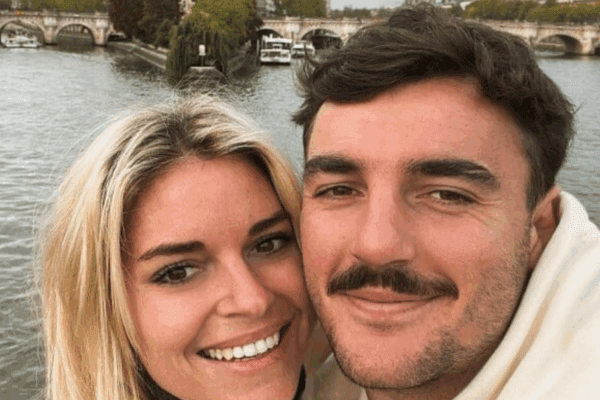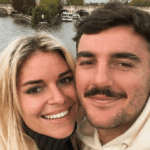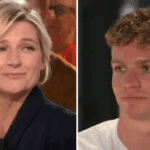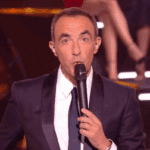« 2 500 euros nets » pour quatre jours de travail par mois : le Cese étrillé dans un rapport parlementaire
La troisième chambre de la République traverse une zone de turbulences. Un rapport parlementaire critique vivement le Conseil économique, social et environnemental (Cese), pointant du doigt un manque d’implication, une faible productivité et une gestion budgétaire peu transparente.

Une remise en cause inédite pour cette institution à vocation consultative, censée incarner le dialogue entre les forces vives de la nation. Dans son rapport d’information présenté ce mercredi 2 juillet, le député Daniel Labaronne (EPR, majorité présidentielle) dépeint un Cese largement déconnecté des attentes en matière d’efficience publique. Parmi les éléments les plus marquants : les conseillers perçoivent en moyenne 2 500 euros net par mois pour un engagement estimé à quatre journées de travail mensuelles. Une rémunération jugée disproportionnée au regard du faible nombre de productions publiées.
Le rapport cite notamment une étude sur la santé au travail, rédigée sur la base de seulement six auditions, ce que le rapporteur qualifie de « modeste » au vu de l’ampleur des enjeux soulevés. Le faible nombre de publications, l’autosaisine privilégiée au détriment des sollicitations gouvernementales, et une concentration des travaux sur des thématiques environnementales sont également vivement critiqués.
Une critique de fond sur l’utilité institutionnelle
Plus largement, le rapport parlementaire questionne la place du Cese dans l’architecture républicaine actuelle. Loin de son ambition initiale d’être la chambre du dialogue social, l’institution semble, selon ses détracteurs, fonctionner en vase clos. Les avis produits restent peu utilisés, tant par le Parlement que par l’exécutif, et certains députés évoquent un « déséquilibre thématique » favorisant l’écologie au détriment des volets économique et social.

Le rapport suggère aussi de restreindre les absences injustifiées des membres, voire d’instaurer un mécanisme de rémunération variable basé sur la présence. Autre recommandation : supprimer les 12 jours de congés spécifiques aux agents du Cese, dont la rémunération moyenne s’élève à 5 678 euros bruts mensuels. Un signal clair adressé à une administration perçue comme privilégiée.
Une réponse du Cese teintée de regrets
Face à cette salve de critiques, le Cese reconnaît certains axes d’amélioration mais dénonce des “raccourcis” injustes. Dans un communiqué, l’institution assure que plusieurs chantiers de réforme sont déjà engagés et souligne le travail réel de ses 175 conseillers, répartis entre représentants des salariés, du patronat, du monde associatif et de l’environnement.
Elle réfute notamment l’idée d’un déséquilibre thématique ou d’une inactivité chronique. Pour autant, le Conseil convient de la nécessité de renforcer son rôle auprès des pouvoirs publics et de mieux valoriser sa plateforme de participation citoyenne, laquelle permet à tout Français de déposer une pétition, à condition de réunir 150 000 signatures.
Des finances dans le collimateur

Au-delà du fond, la gestion financière du Cese est aussi dans le viseur. Le rapport demande une publicité complète des comptes, alors que le budget alloué pour 2025 s’élève à 34,4 millions d’euros. La Cour des comptes, qui doit publier prochainement un rapport spécifique, aurait déjà pointé dans ses observations provisoires un manque de clarté dans les données communiquées.
Selon les révélations du Canard enchaîné en mars dernier, la transparence budgétaire du Cese laisse à désirer, une critique récurrente dans les institutions publiques, mais particulièrement sensible dans un contexte de rigueur budgétaire croissante.
Une réforme en ligne de mire ?
Cette succession de critiques remet en lumière la place contestée du Cese dans l’écosystème institutionnel français. Réformé en 2021 pour intégrer davantage la parole citoyenne, notamment via les conventions citoyennes, l’institution peine à convaincre de son utilité stratégique. Certains députés plaident même pour sa transformation en un véritable organe d’évaluation des politiques publiques, plus directement lié au Parlement.